C’est la suture de ce lambeau (Fig. 9) qui va permettre de maintenir une épaisseur de gencive kératinisée nécessaire. Le biotype gingival de cette zone est donc amélioré, afin d’assurer la pérennité de notre réhabilitation.

Fig. 9.
Les deux implants antérieurs seront tout d’abord posés afin de respecter un positionnement idéal pour un futur vissage palatin de la prothèse, puis les deux implants postérieurs seront inclinés à 20 degrés (protocole classique décrit par le Dr Malo).4 Ensuite des piliers coniques multi-unit droits en antérieur et de 17 degrés en postérieurs, sont vissés sur nos implants. Enfin les scan bodies sont placés avant les sutures, afin d’assurer un contrôle visuel de leur bonne position, ainsi qu’une bonne adaptation.
La réalisation d’un bridge transvissé usiné en PMMA avec vario-bases pour piliers multi-unit (Fig. 11) est usinée après l’utilisation de la caméra iTero pour l’empreinte des scan bodies au maxillaire.
Pour ce faire nous enregistrons la position des quatre scan bodies au maxillaire en postopératoire et le laboratoire superposera ce fichier STL, aux fichiers STL enregistrés initialement du maxillaire en occlusion avec la mandibule, ceci dans le but de mettre l’empreinte postopératoire avec scan bodies en occlusion avec le modèle mandibulaire, qui a déjà reçu un bridge provisoire transvissé quelques semaines auparavant.
Trois mois après la dernière chirurgie (Fig. 12), le patient revient pour contrôler la cicatrisation, l’ostéointégration, et prendre l’empreinte. Les tissus mous sont sains et le patient maintient une hygiène idéale, ce qui est essentiel pour préserver la santé des tissus péri-implantaires.
À ce stade-là (Fig. 13), les particules de comblement de GTO (comblement xénogénique), utilisées afin de combler les alvéoles maxillaires, sont encore présentes dans l’épaisseur gingival car elles ne sont pas encore intégrées aux tissus mous, mais la mise en condition gingivale guidée par le design et la compression du bridge provisoire, permettent déjà un aménagement idéal pour la réalisation de la prothèse définitive à venir.
Au niveau mandibulaire (Fig. 14), la cicatrisation mandibulaire de la gencive autour des implants tissue levels est optimale. Nous ne recherchons pas une mise en condition gingivale particulière car à la mandibule la pérennité s’inscrira dans une hygiène adaptée, et donc nous allégeons volontairement l’intrados, afin d’optimiser le passage des brossettes par le patient
La radio panoramique (Fig. 15), quant à elle, nous montre une uniformité dans la répartition de la position des implants, ainsi qu’une connexion pilier conique-implant de type cône morse du All-on-4 au maxillaire, ce qui assure une étanchéité nécessaire à des implants posés en position infra-osseuse. Nous observons un cas classique de réhabilitation par quatre implants verticaux à la mandibule.
Les deux bridges provisoires sont vissés par l’intermédiaire de vario-bases à la mandibule et au maxillaire (Fig. 16). Nous réhabilitons le patient grâce à la réalisation d’un bridge full zircone à connexion directe sur multi-unit au maxillaire.
À la mandibule un bridge PMMA sur vario-base est vissé. Nous n’optons pas pour la réalisation de deux bridges full zircone, pour des questions de dureté de matériaux et de confort pour le patient. Nous combinons l’esthétique d’un bridge full zircone au maxillaire et la souplesse du PMMA à la mandibule (Fig. 17). La photo avant-après du patient, illustrant son état au premier jour et à la fin de son traitement, est présentée sur la figure 18.
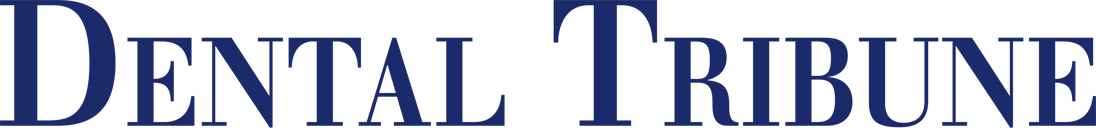


 Autriche / Österreich
Autriche / Österreich
 Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина
Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина
 Bulgarie / България
Bulgarie / България
 Croatie / Hrvatska
Croatie / Hrvatska
 République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko
République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko
 France / France
France / France
 Allemagne / Deutschland
Allemagne / Deutschland
 Grèce / ΕΛΛΑΔΑ
Grèce / ΕΛΛΑΔΑ
 Hongrie / Hungary
Hongrie / Hungary
 Italie / Italia
Italie / Italia
 Pays-Bas / Nederland
Pays-Bas / Nederland
 Nordique / Nordic
Nordique / Nordic
 Pologne / Polska
Pologne / Polska
 Portugal / Portugal
Portugal / Portugal
 Roumanie & Moldavie / România & Moldova
Roumanie & Moldavie / România & Moldova
 Slovénie / Slovenija
Slovénie / Slovenija
 Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора
Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора
 Espagne / España
Espagne / España
 Suisse / Schweiz
Suisse / Schweiz
 Turquie / Türkiye
Turquie / Türkiye
 Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland
Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland
 International / International
International / International
 Brésil / Brasil
Brésil / Brasil
 Canada / Canada
Canada / Canada
 Amérique latine / Latinoamérica
Amérique latine / Latinoamérica
 États-Unis / USA
États-Unis / USA
 Chine / 中国
Chine / 中国
 Inde / भारत गणराज्य
Inde / भारत गणराज्य
 Pakistan / Pākistān
Pakistan / Pākistān
 Vietnam / Việt Nam
Vietnam / Việt Nam
 ANASE / ASEAN
ANASE / ASEAN
 Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
 Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس
Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس
 Moyen-Orient / Middle East
Moyen-Orient / Middle East





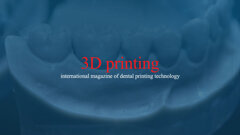
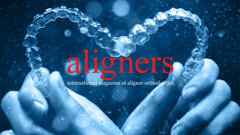


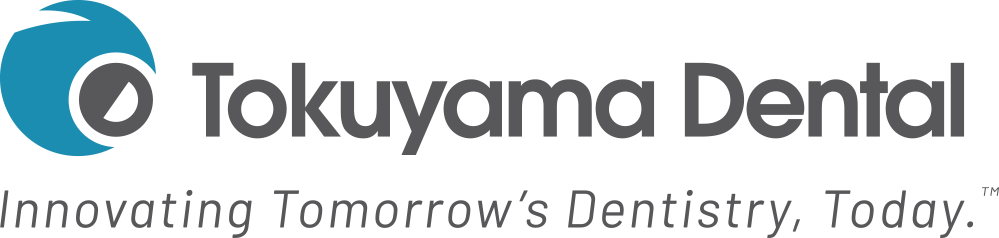









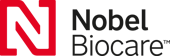
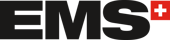












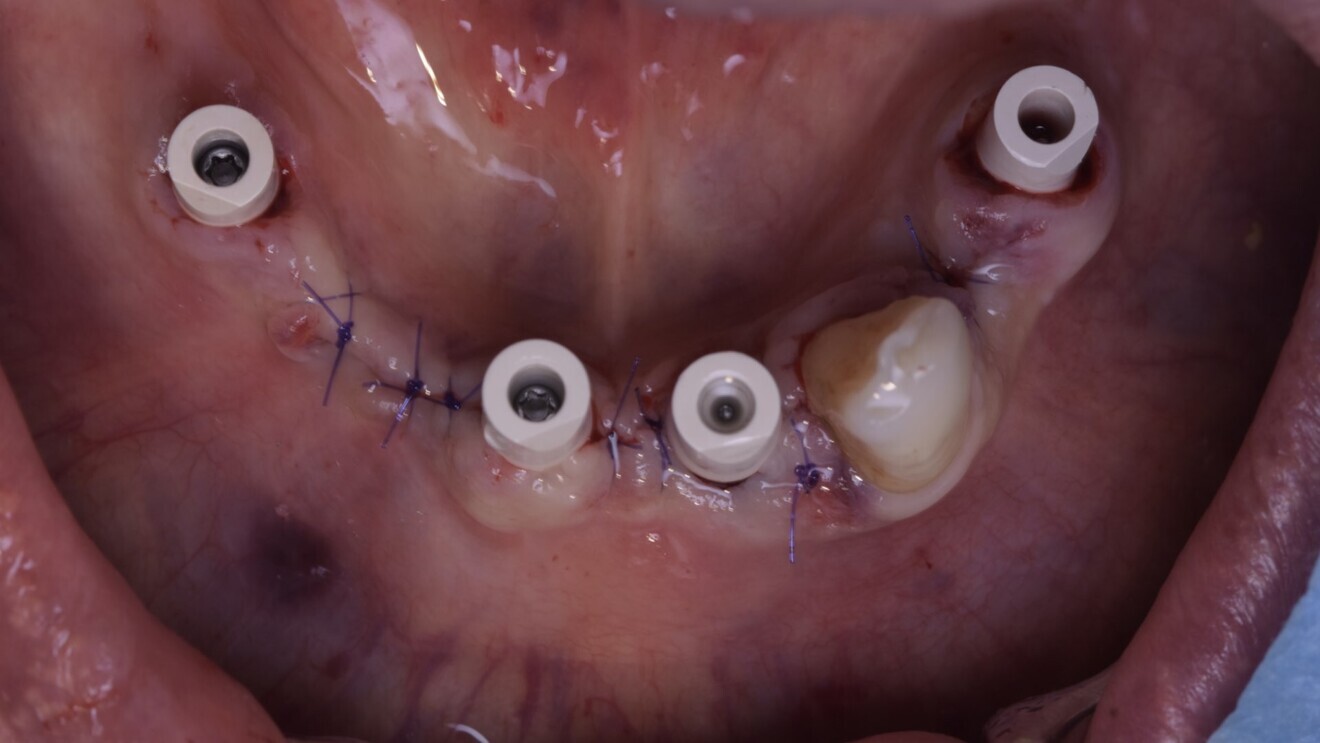
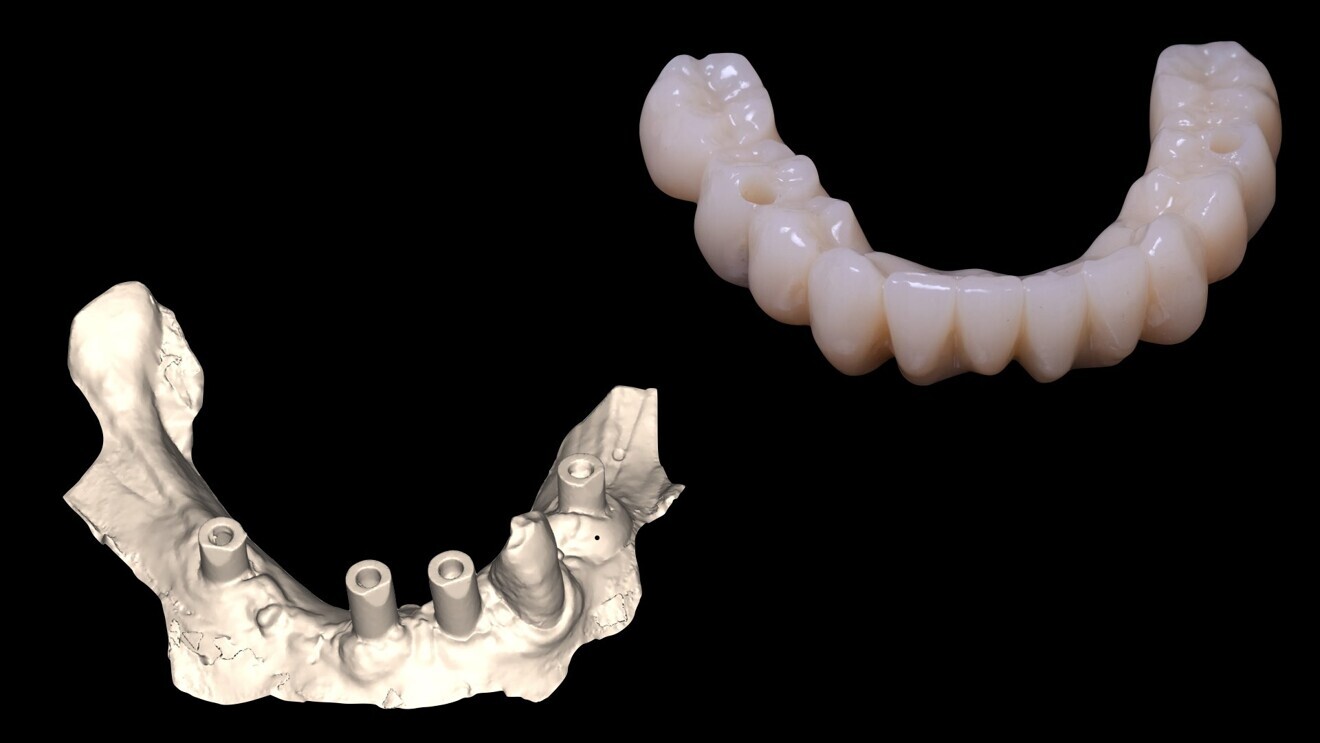

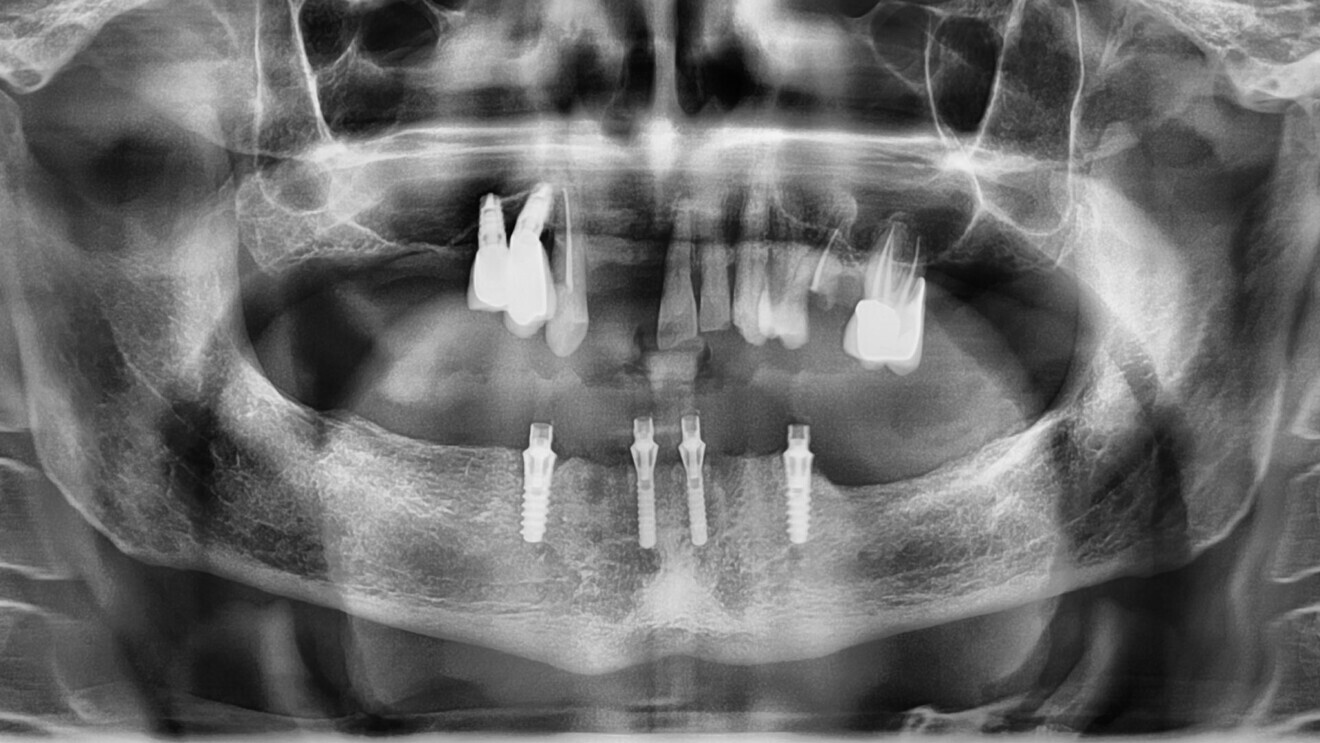

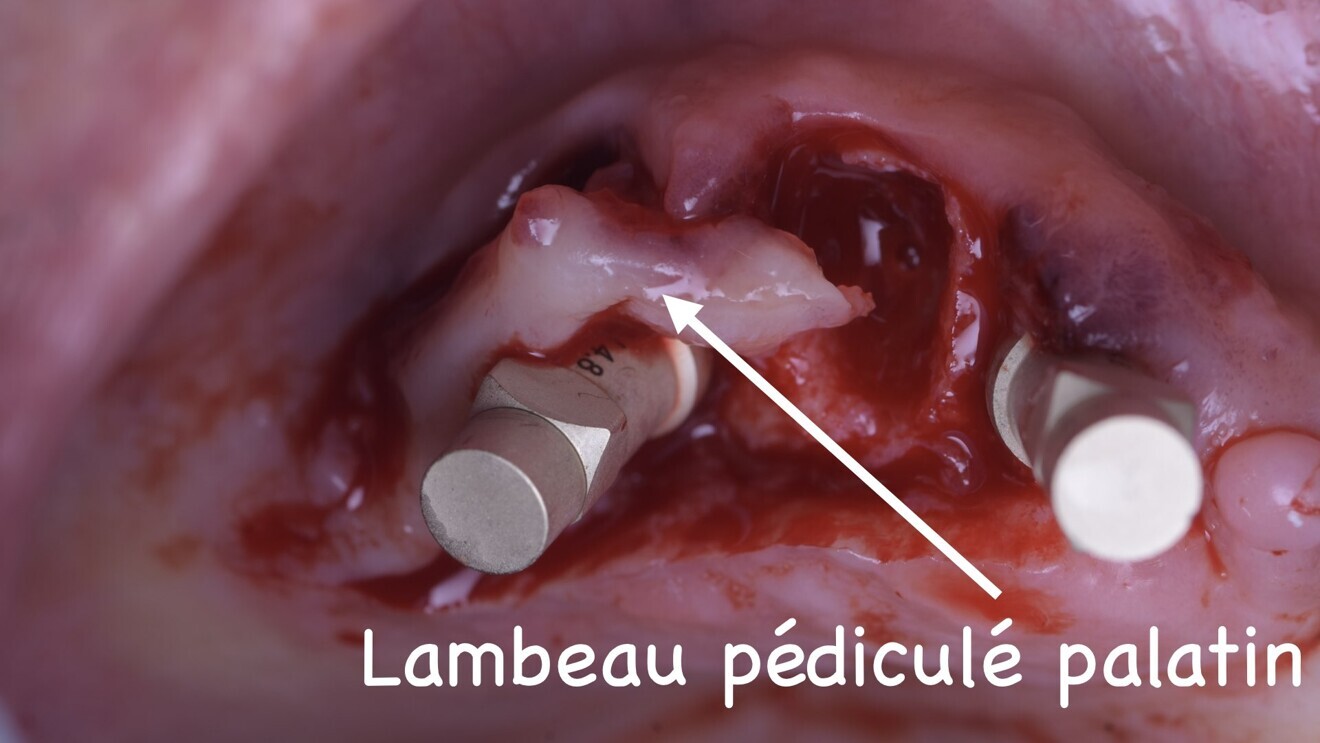

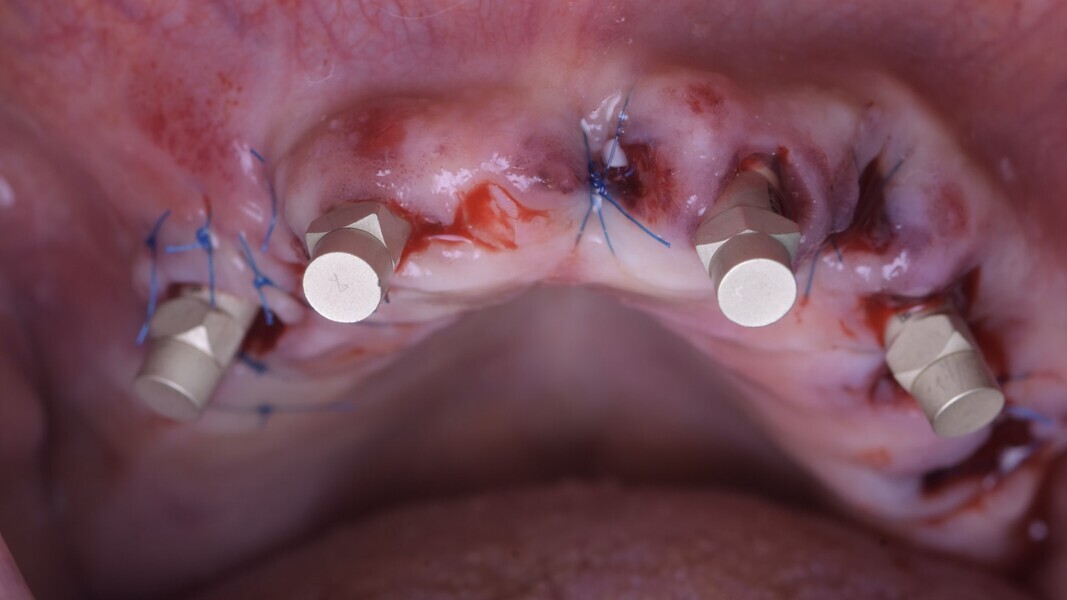


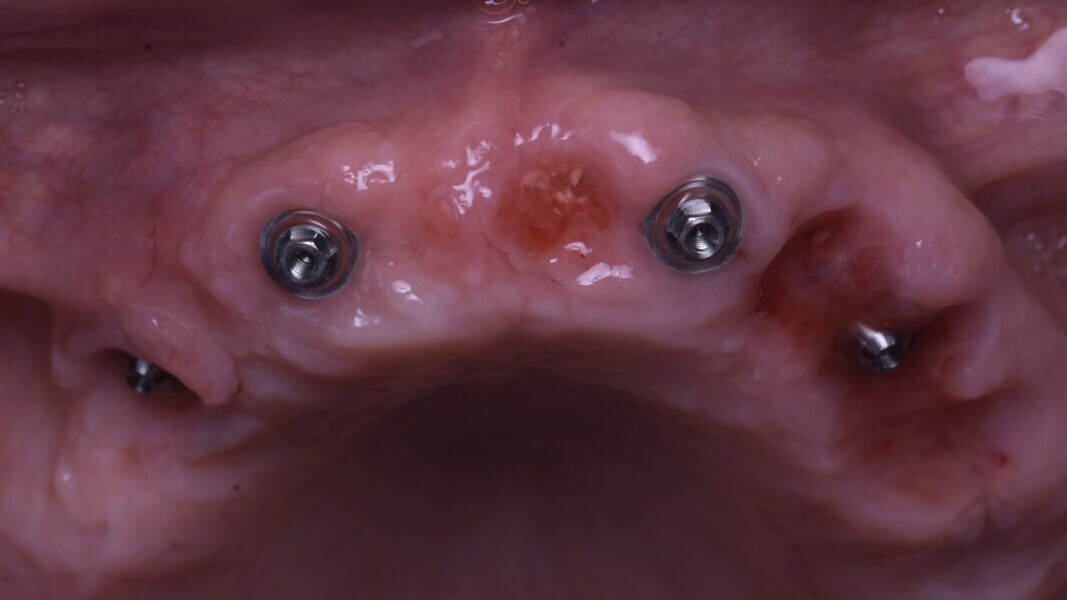
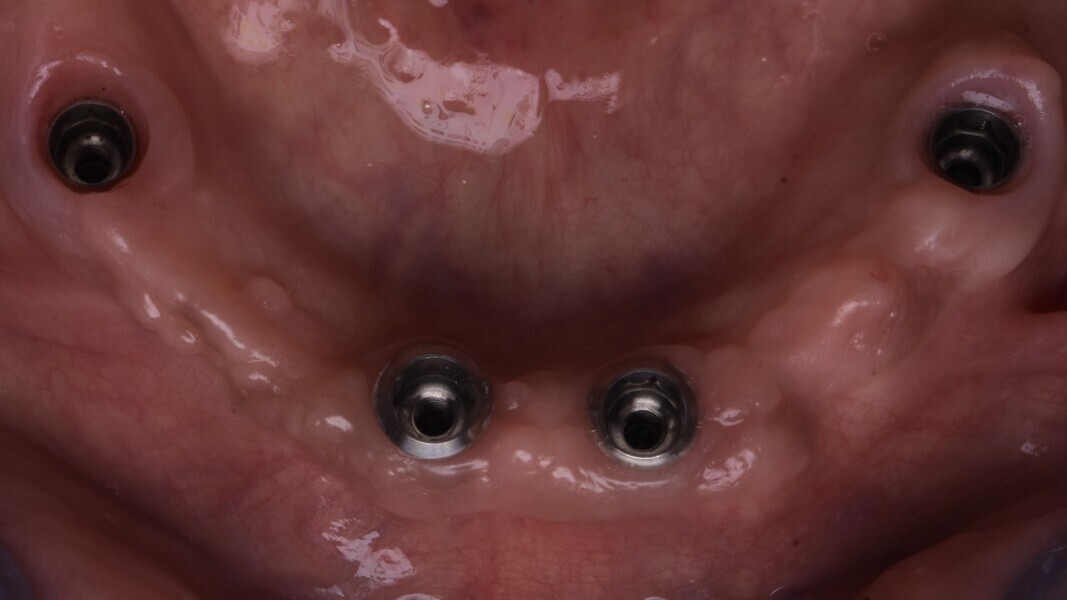
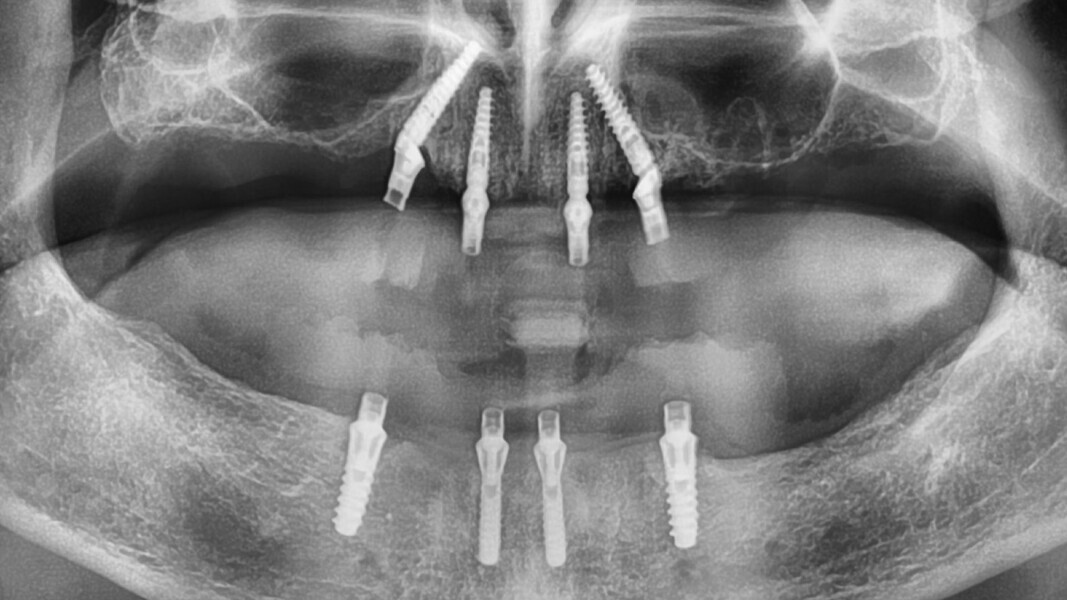




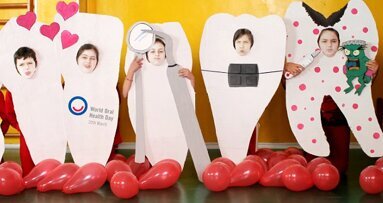
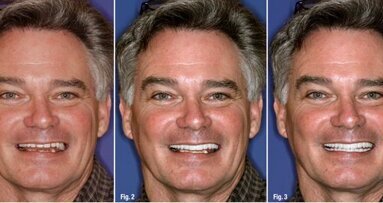









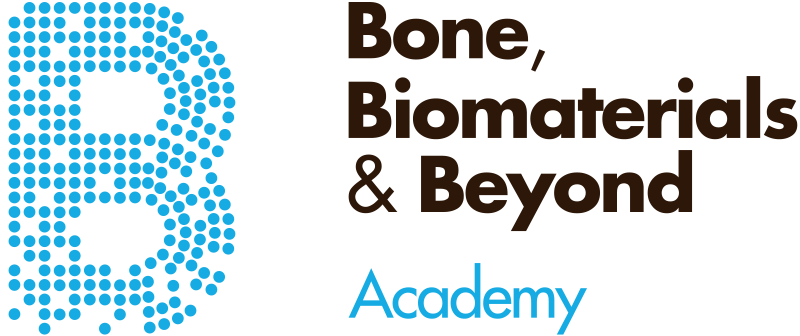



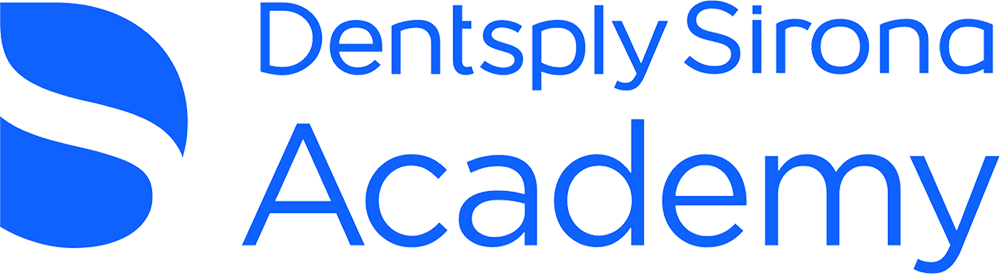














To post a reply please login or register