Discussion
Les greffons radiculaires en tant que matériaux de greffes partagent de nombreuses caractéristiques avec l’os autogène, ainsi que certains avantages des biomatériaux.En outre, il s’agit de matériaux autogènes constitués d’une fraction minérale, d’une fraction organique (protéines du patient) et d’eau, dans des proportions comparables à celles de l’os alvéolaire ;3 ils sont reconnus comme faisant partie du corps du patient et n’entraînent pas de réactions inflammatoires « à corps étrangers ». Ils sont extrêmement compliants avec les tissus mous qui les recouvrent, pour autant qu’il ne subsiste pas d’arêtes vives ou tranchantes lors de la fermeture ; on obtient une cicatrisation rapide d’excellente qualité. On peut les utiliser de deux façons différentes soit comme bloc à part entière,3, 4, 5, 6, 7 soit comme « membrane biologique » associé à un biomatériau ou à des copeaux d’os autogène collectés localement.
Dans un premier temps, il y a une ankylose de la racine sur la crête puis une résorption centrifuge de remplacement de celle-ci.3 La racine est résorbée et remplacée par de l’os selon le principe de la résorption radiculaire, il s’agit d’une ankylose dirigée, mais également, lorsque le greffon est fixé à distance de la crête. Il y a une néoformation osseuse en regard de la dentine. Le matériau présente des propriétés d’ostéo-conduction et d’ostéo-induction.3, 4, 5, 8, 9
Les greffons sont faciles à prélever. Il n’y a pas de protocole ou de délai de conservation particulier : durant l’intervention, avant utilisation, il est tout à fait possible de les laisser à l’air libre sur le champ opératoire, sans aucune conséquence. Il s’agit de blocs solides insensibles aux tractions musculaires, qui se travaillent aisément avec une fraise ou un disque. Ils permettent de restaurer l’horizontalité de la crête, et ont une certaine plasticité3, 4, 6, 8, 9 ce qui permet de légèrement les contraindre, pour leur donner une courbure sans qu’ils ne cassent. Leur résorption lente leur confère une grande stabilité volumétrique dans le temps, qui fait que l’on retrouve toujours le volume greffé.4, 6, 7, 12 L’inconvénient majeur est la disponibilité. Racines extraites lors d’extraction/implantation, dents de sagesses, dents condamnées, etc. le matériau reste disponible en quantité limitée.
Conclusion
Dans les cas présentés cette technique nous a permis, avec succès, d’associer la pose des implants à la reconstruction osseuse, et une mise en place d’un provisoire le jour même. Les objectifs chirurgicaux, mécaniques et esthétiques ont été atteints en minimisant le traumatisme chirurgical, ainsi que la durée de traitement pour nos patients, puisqu’ils n’ont eu à subir qu’une seule intervention.
Sur le long terme nous avons obtenu une reconstruction de la crête ad integrum, une résorption complète des greffons radiculaires à 2 ans (cas 1) et à 3 ans (cas 2), et une stabilité volumétrique dans le temps du volume reconstruit. Compte tenu des caractéristiques et des nombreux avantages liés à ces « greffons radiculaires » cette technique est devenue notre choix en première intention, lorsqu’il y a des racines condamnées disponibles.
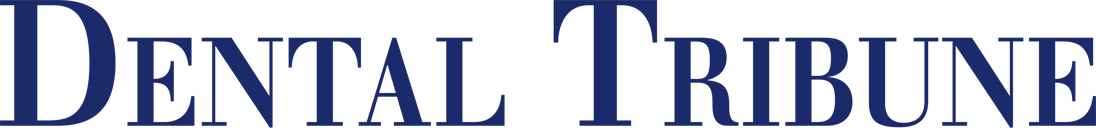


 Autriche / Österreich
Autriche / Österreich
 Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина
Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина
 Bulgarie / България
Bulgarie / България
 Croatie / Hrvatska
Croatie / Hrvatska
 République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko
République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko
 France / France
France / France
 Allemagne / Deutschland
Allemagne / Deutschland
 Grèce / ΕΛΛΑΔΑ
Grèce / ΕΛΛΑΔΑ
 Hongrie / Hungary
Hongrie / Hungary
 Italie / Italia
Italie / Italia
 Pays-Bas / Nederland
Pays-Bas / Nederland
 Nordique / Nordic
Nordique / Nordic
 Pologne / Polska
Pologne / Polska
 Portugal / Portugal
Portugal / Portugal
 Roumanie & Moldavie / România & Moldova
Roumanie & Moldavie / România & Moldova
 Slovénie / Slovenija
Slovénie / Slovenija
 Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора
Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора
 Espagne / España
Espagne / España
 Suisse / Schweiz
Suisse / Schweiz
 Turquie / Türkiye
Turquie / Türkiye
 Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland
Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland
 International / International
International / International
 Brésil / Brasil
Brésil / Brasil
 Canada / Canada
Canada / Canada
 Amérique latine / Latinoamérica
Amérique latine / Latinoamérica
 États-Unis / USA
États-Unis / USA
 Chine / 中国
Chine / 中国
 Inde / भारत गणराज्य
Inde / भारत गणराज्य
 Pakistan / Pākistān
Pakistan / Pākistān
 Vietnam / Việt Nam
Vietnam / Việt Nam
 ANASE / ASEAN
ANASE / ASEAN
 Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
 Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس
Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس
 Moyen-Orient / Middle East
Moyen-Orient / Middle East





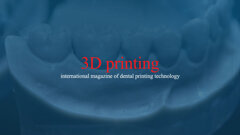
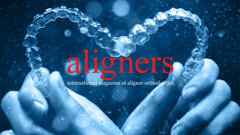


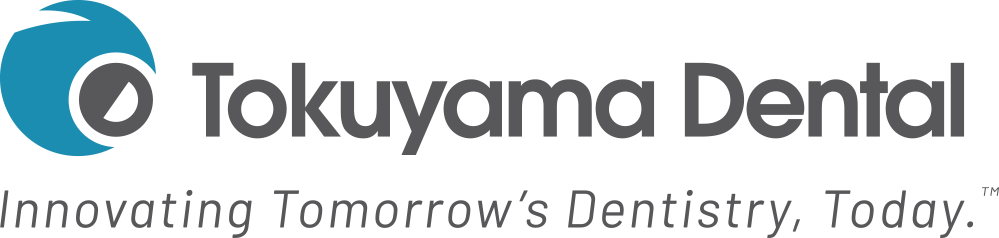









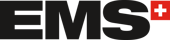















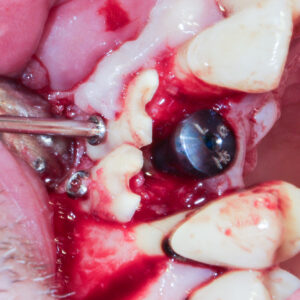



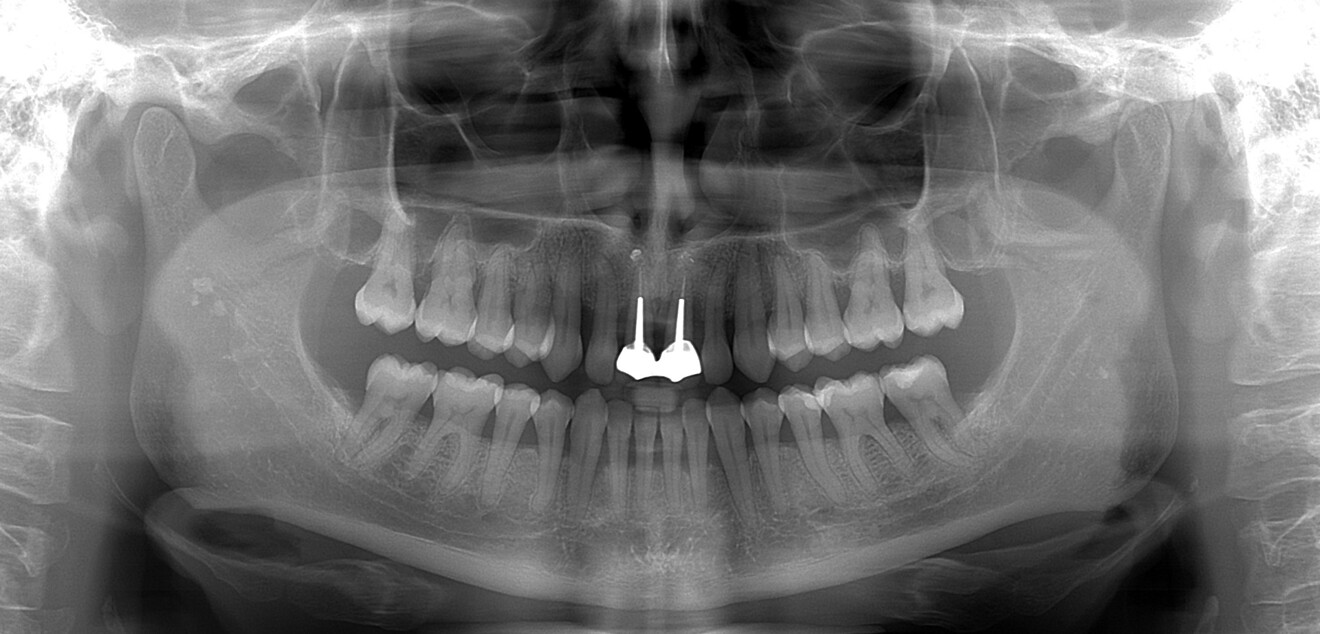
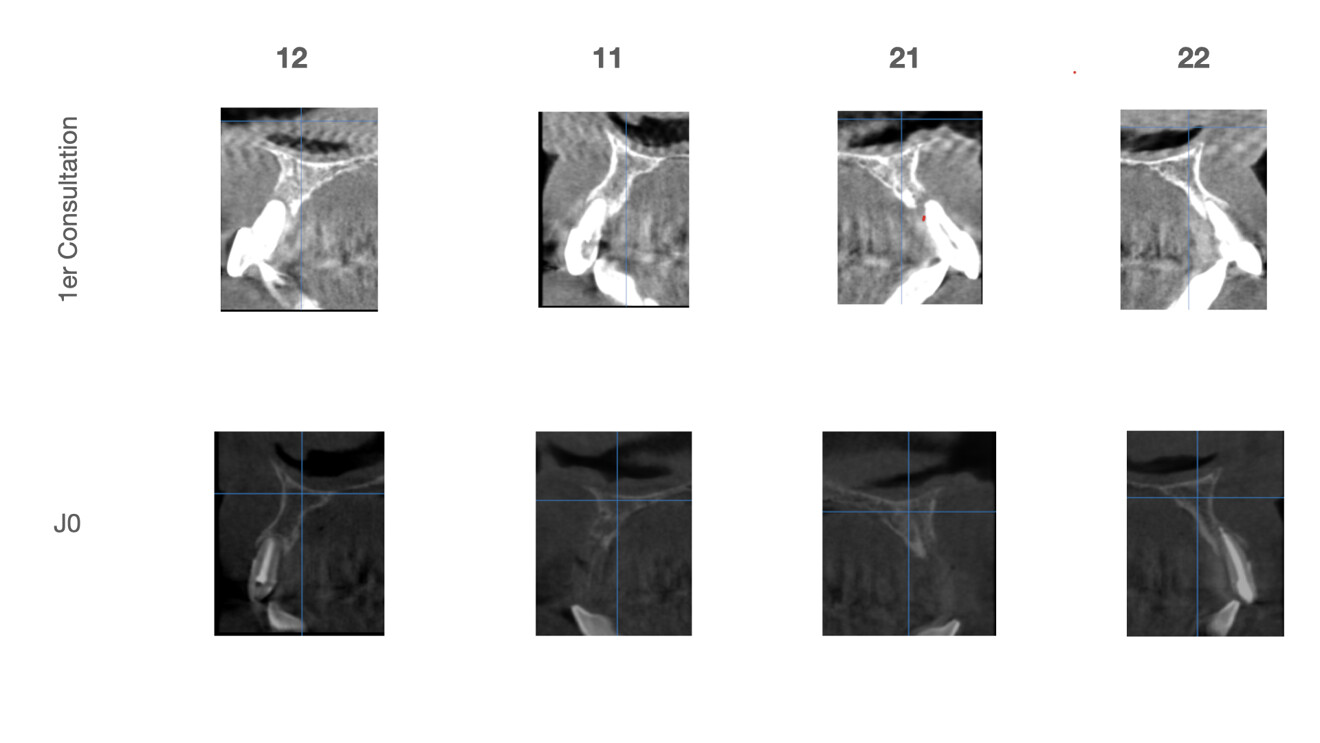
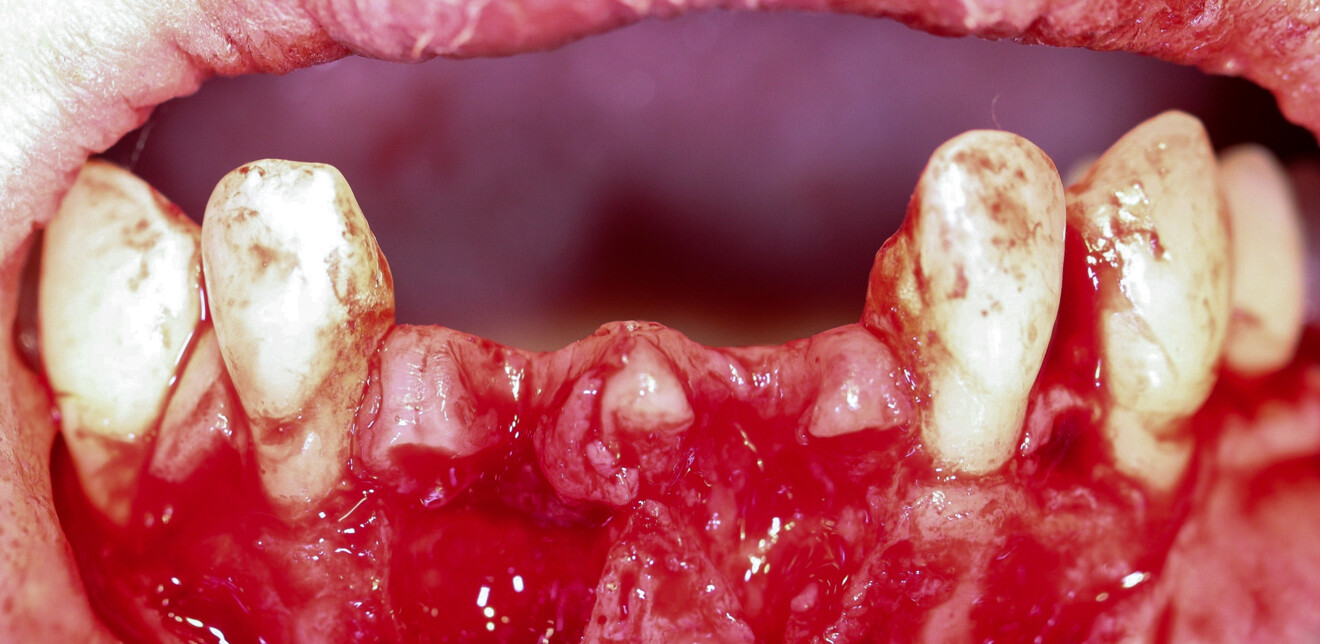
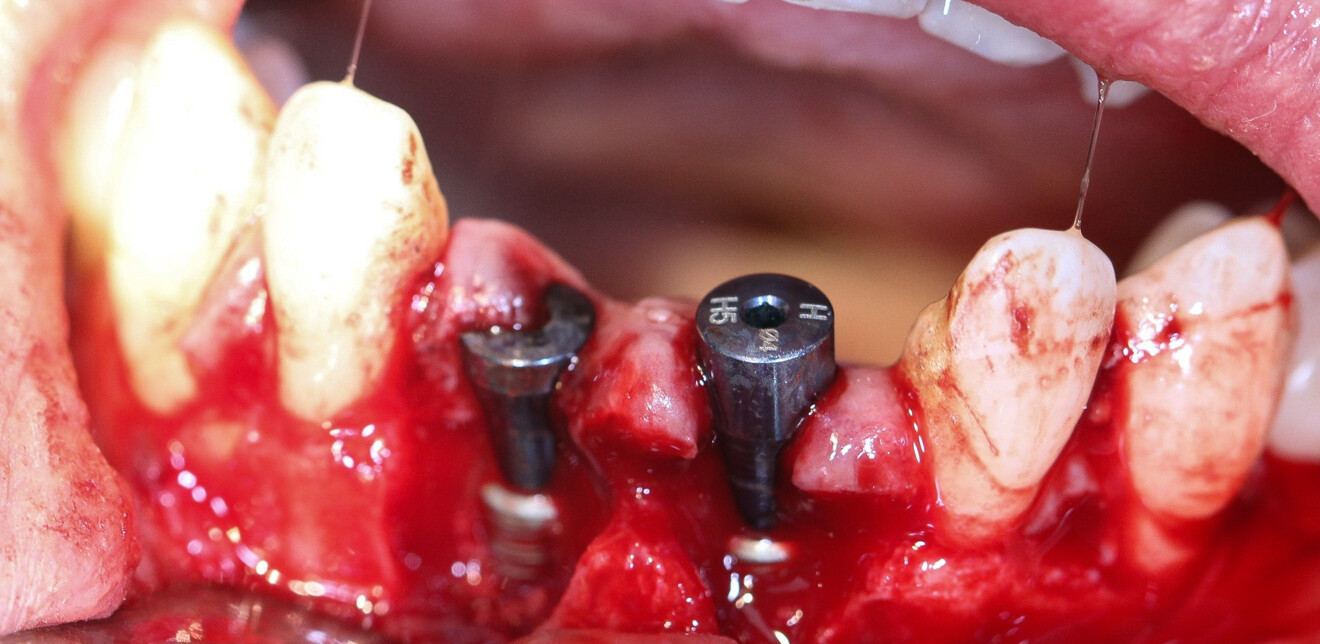
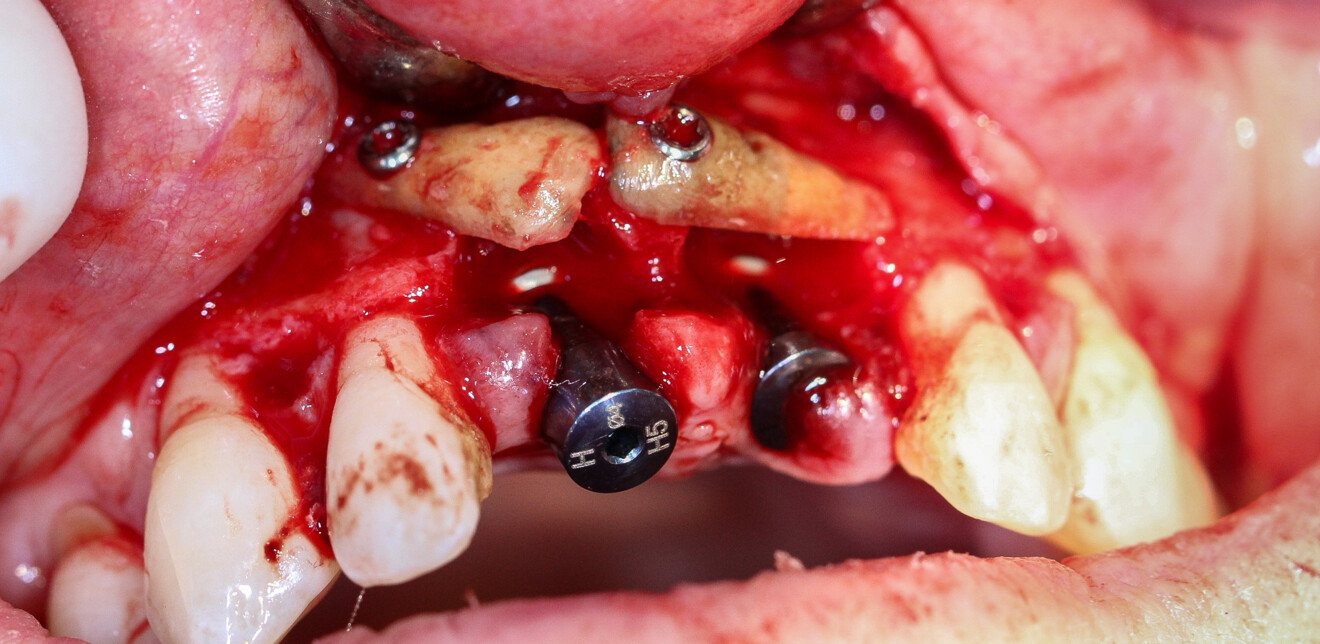

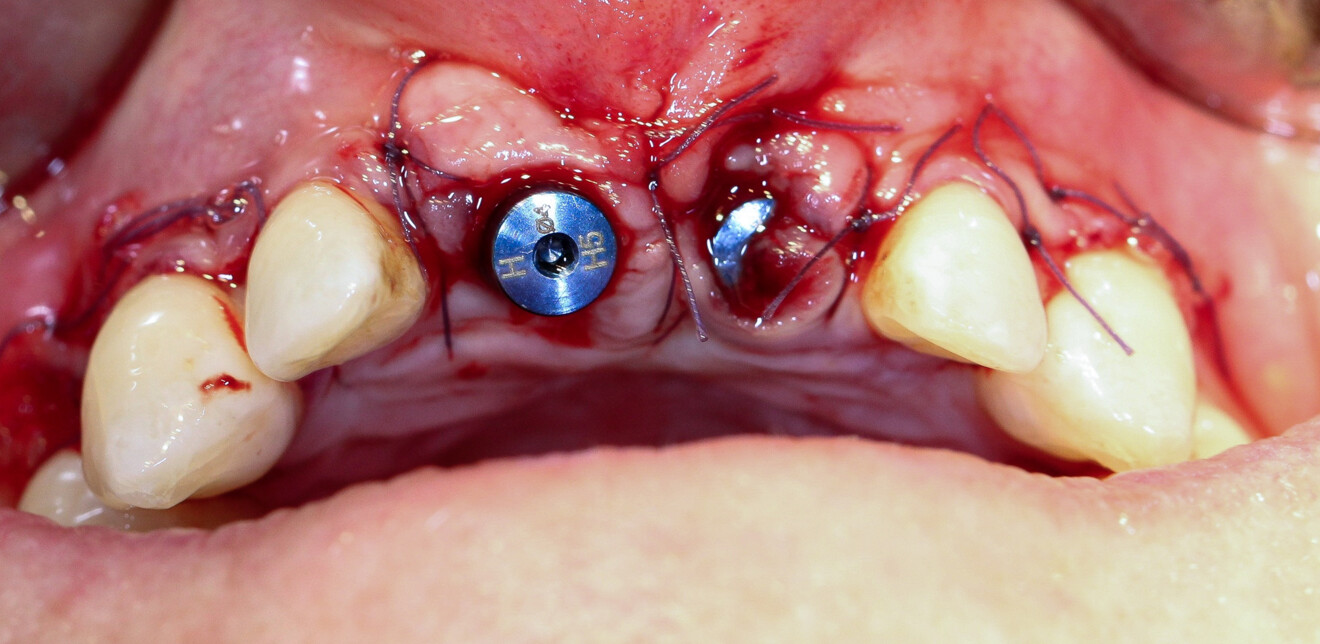

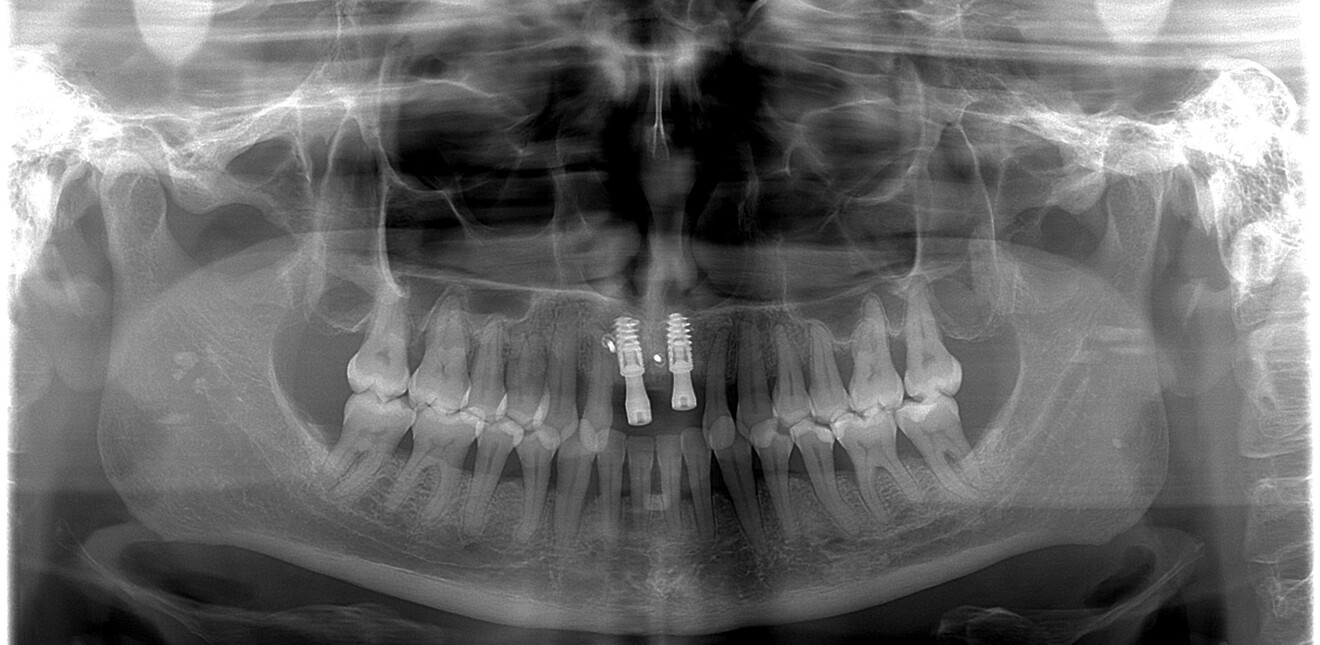

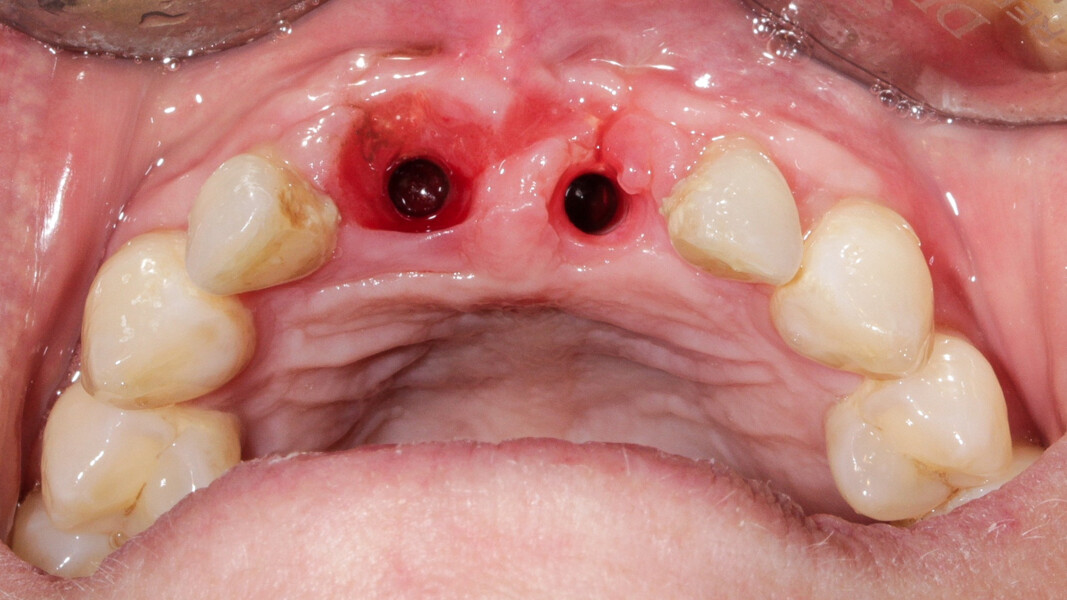


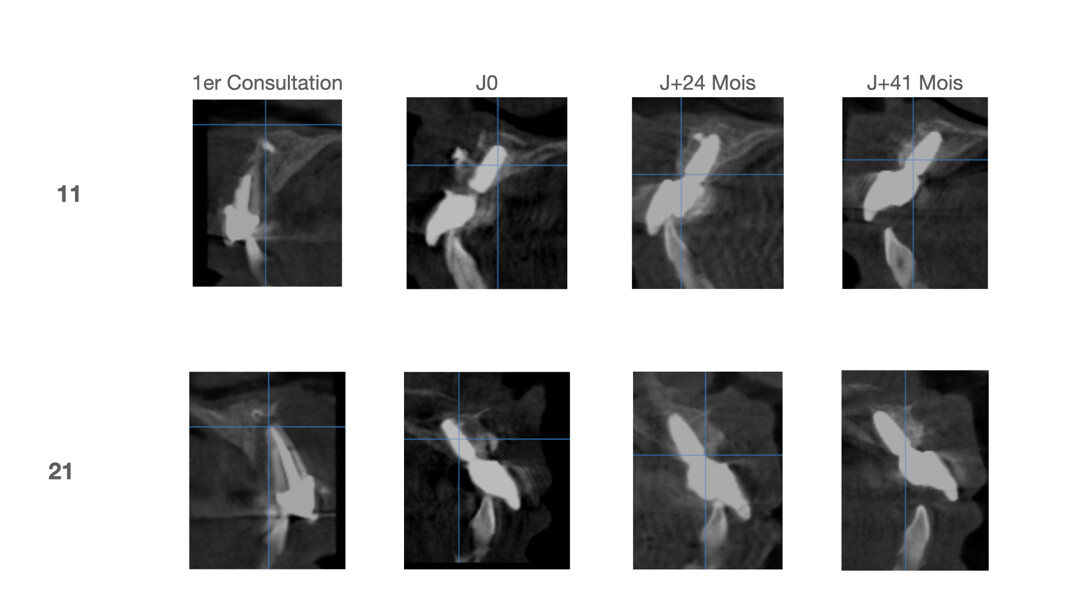



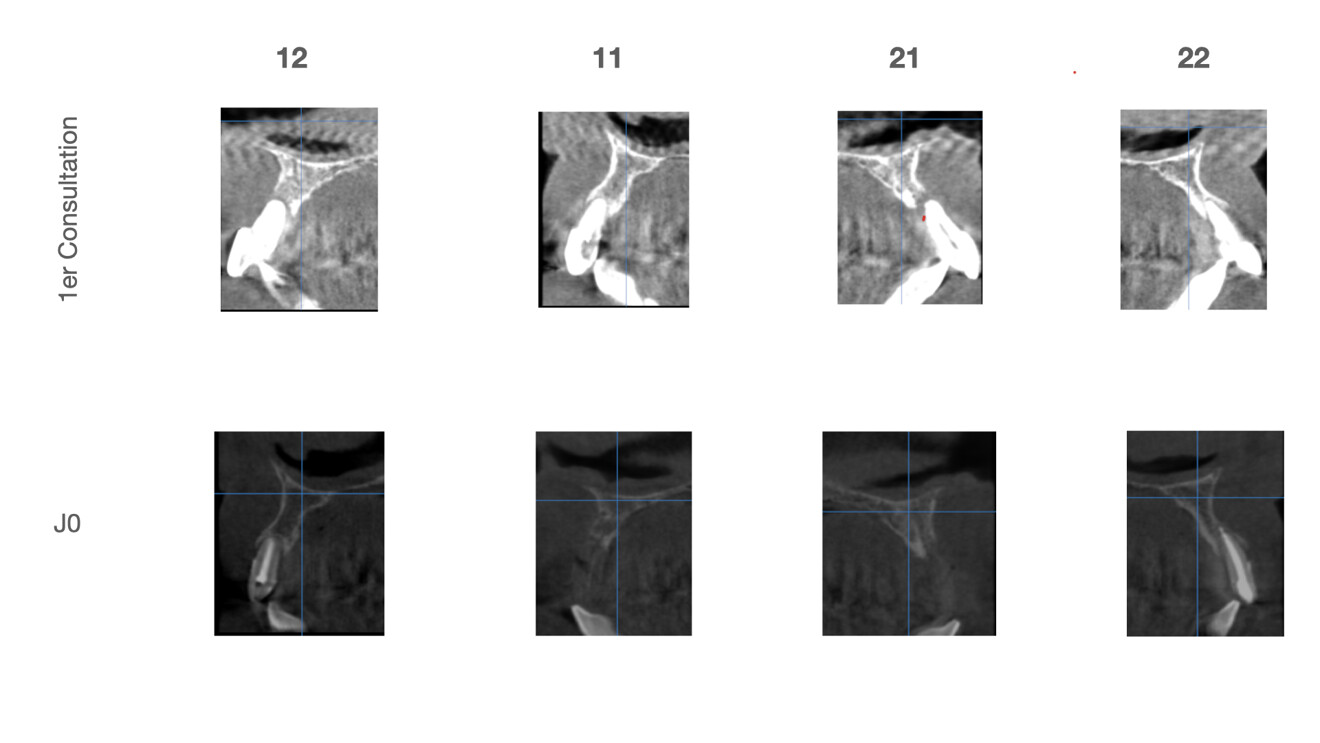

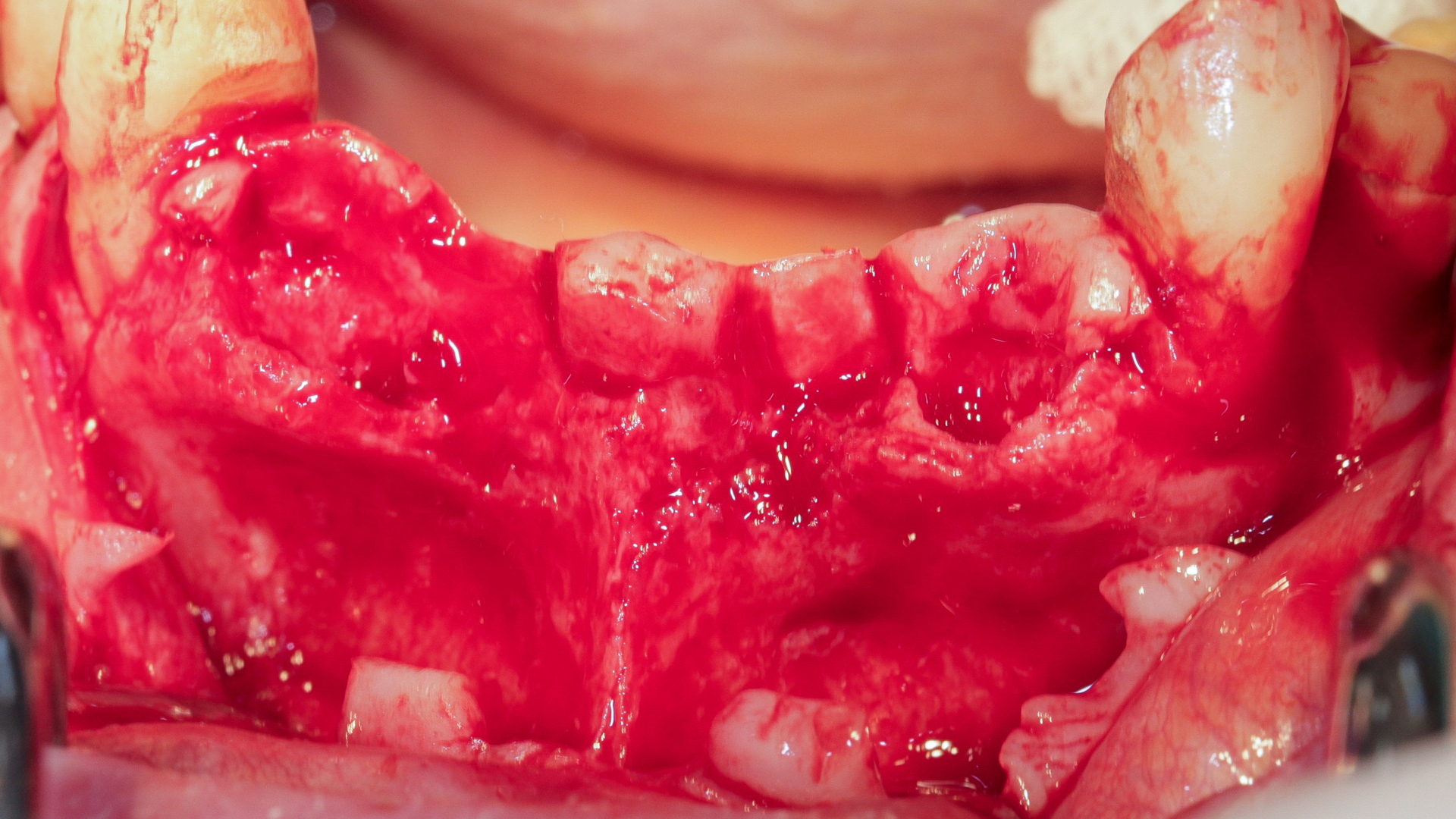
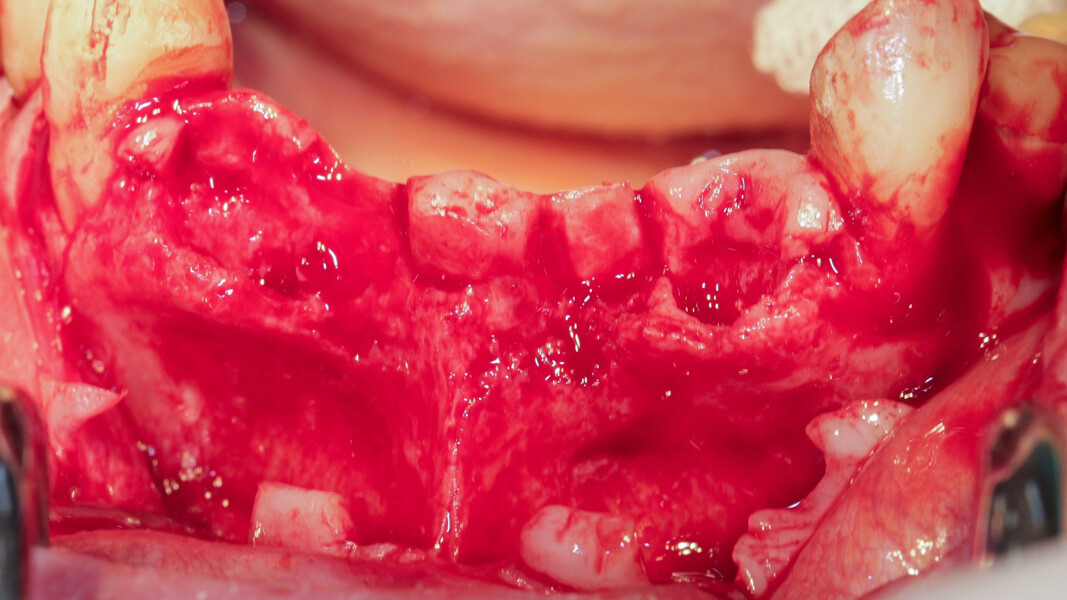
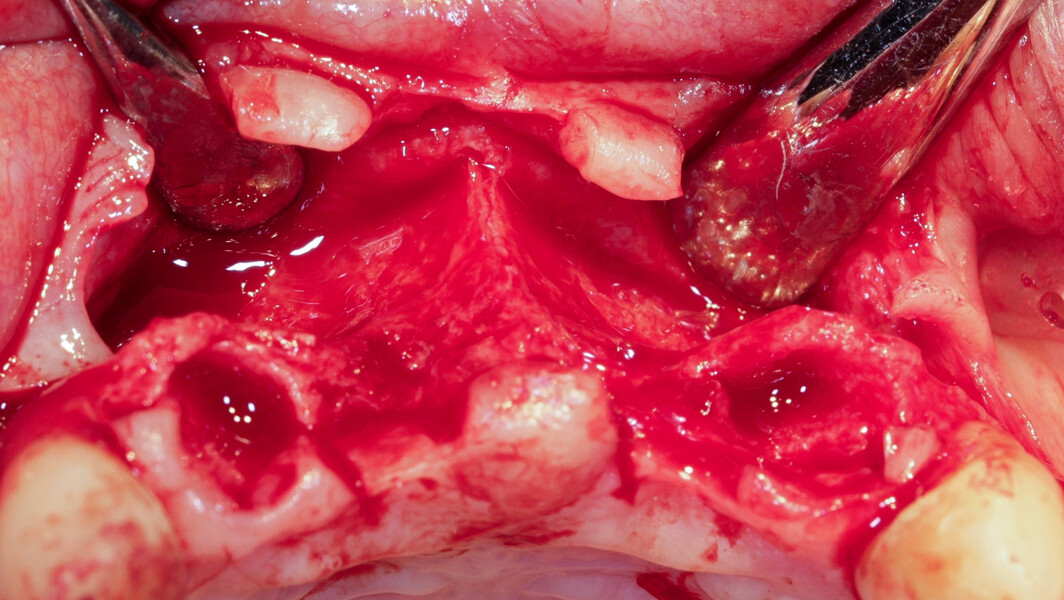
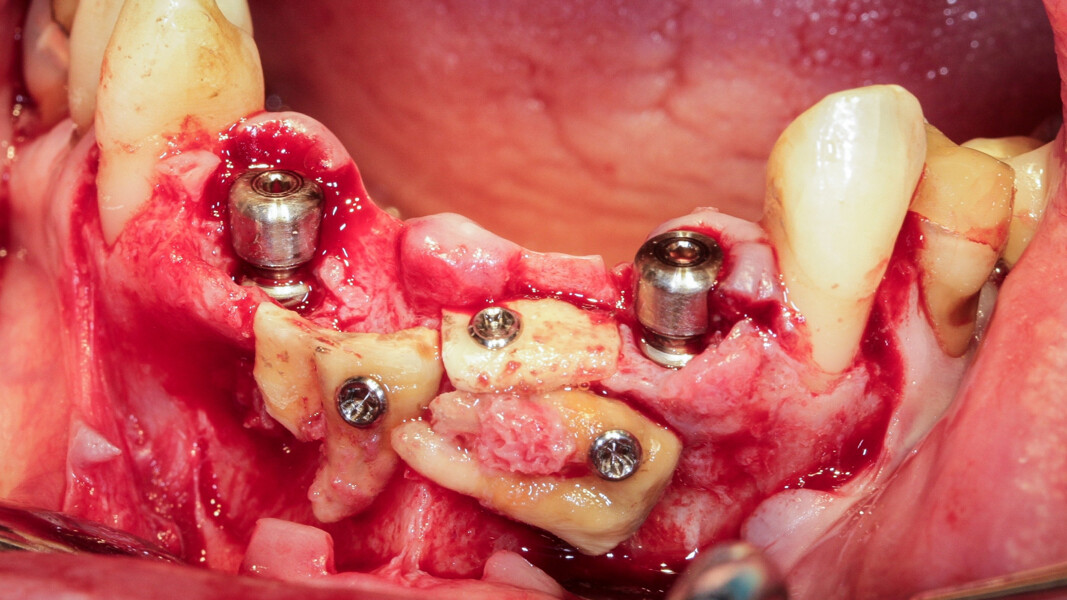
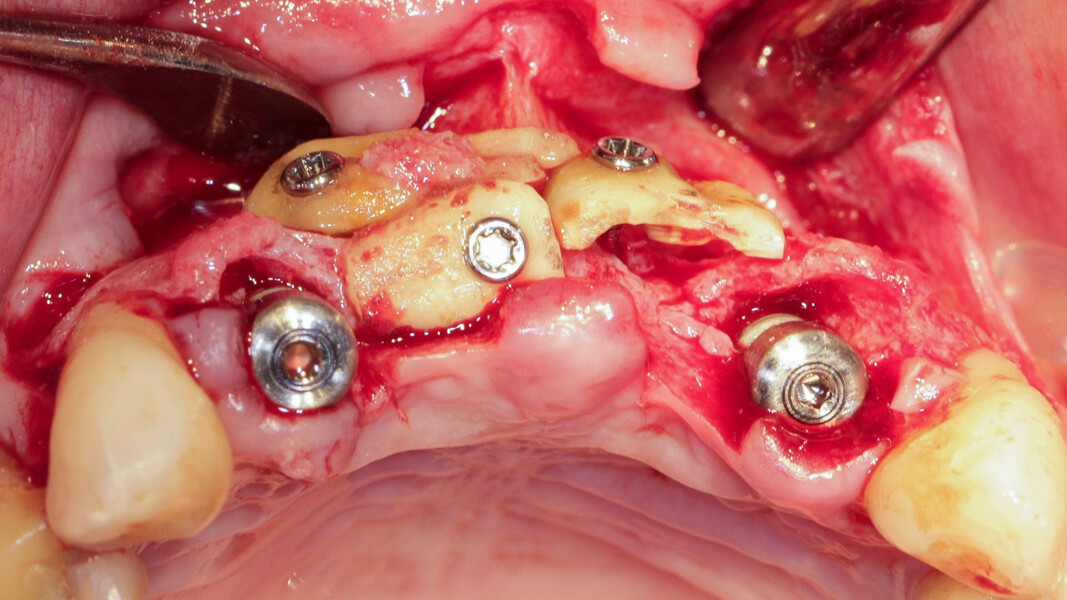
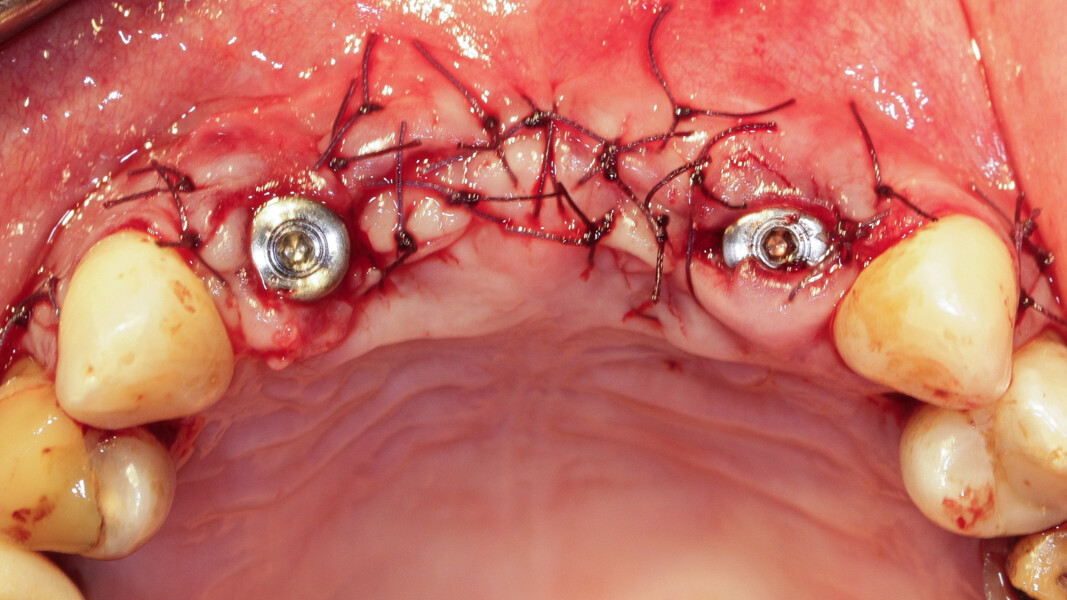
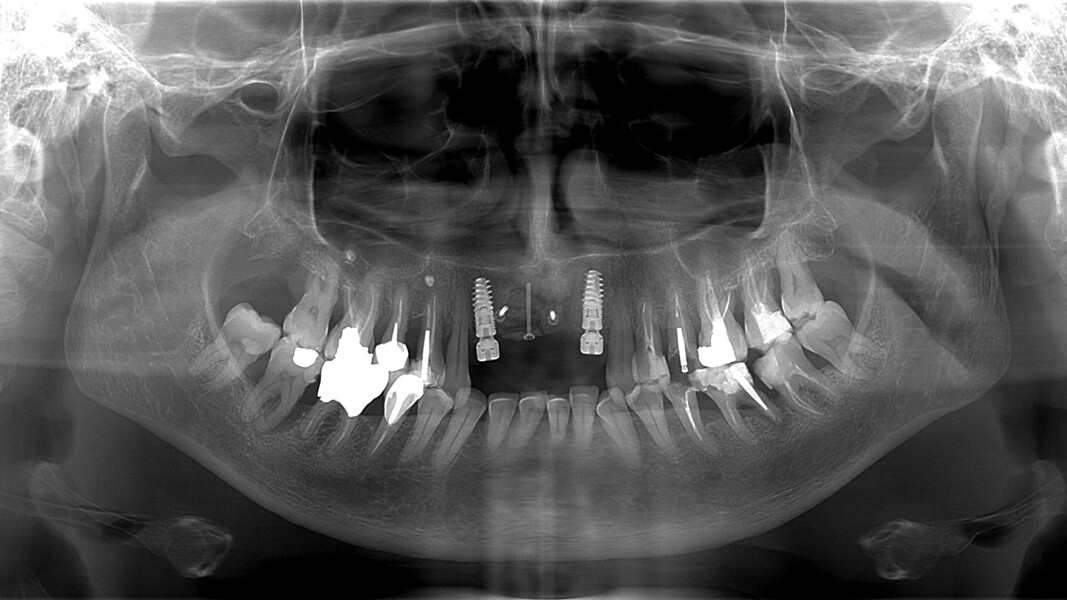



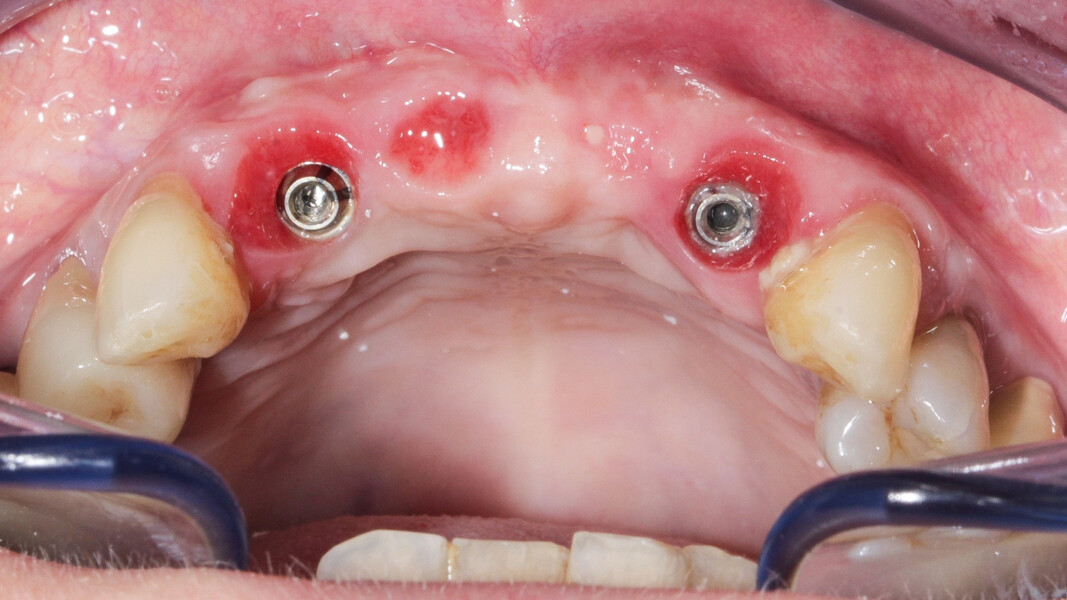

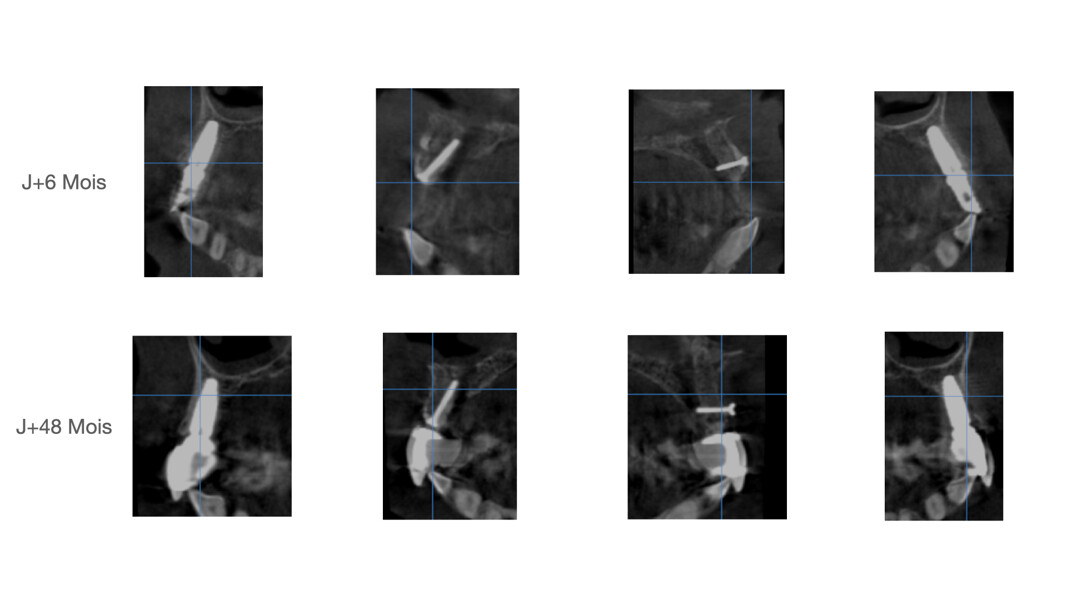





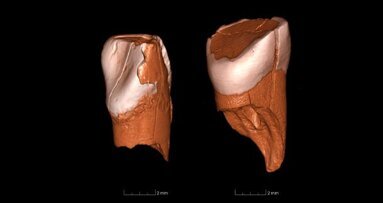


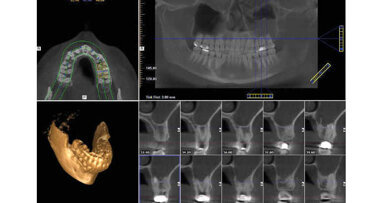



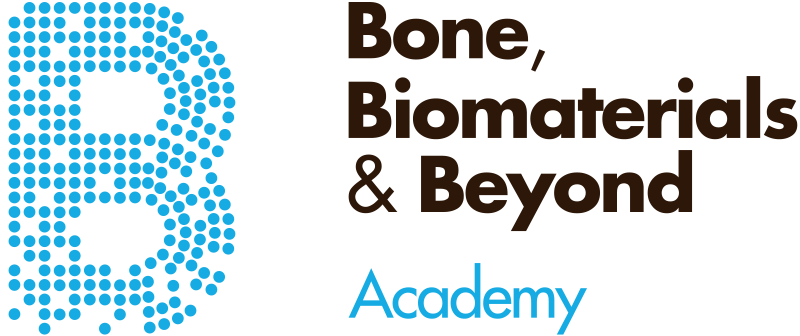



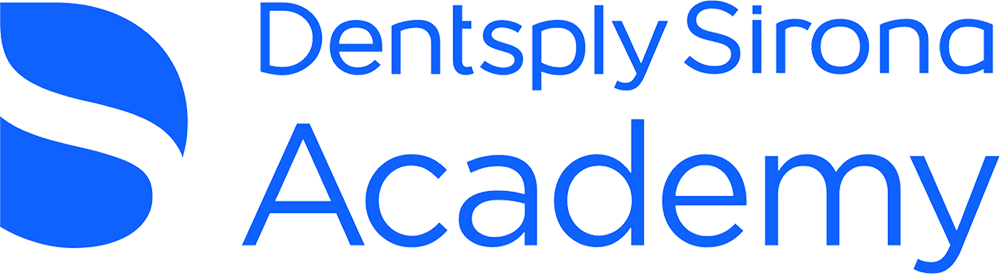














To post a reply please login or register